
Les menaces croissantes liées aux changements globaux constituent une urgence mondiale pour laquelle les secteurs et les individus doivent s’adapter. Consciente de cette nécessité, la France a lancé son troisième Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, qui envisage une stratégie d’adaptation territoriale pour une France à +4°C d’ici 2100. Cette attention croissante portée à l’adaptation souligne le besoin de services climatiques fournissant des connaissances exploitables pour soutenir la prise de décision et la planification des politiques publiques. Or, les services climatiques existants ciblent principalement des secteurs économiques spécifiques (énergie, agriculture, tourisme), alors que l’adaptation territoriale nécessite une approche intersectorielle intégrant les interactions climatiques, les seuils critiques et les interdépendances socio-écosystémiques.
Une adaptation efficace repose donc sur des décisions transformatrices fondées sur des données climatiques fiables et utilisables, adaptées aux vulnérabilités et aux capacités locales. Les principaux obstacles à l’appropriation et à l’utilisation généralisée des services climatiques résident dans la nécessité d’une compréhension mutuelle entre perspectives scientifiques et socio-techniques, ainsi qu’une collaboration efficace entre la science et la société. Une approche de partage des connaissances intégrant une diversité d’expertises est alors essentielle pour adapter l’information climatique aux besoins des décideurs, à leurs vulnérabilités et aux contextes institutionnels.
Dans ce contexte, cette thèse inter- et transdisciplinaire vise à développer des méthodes participatives et des outils d’aide à la décision fondés sur la narration pour concevoir des expérimentations inclusives impliquant scientifiques, acteurs locaux et citoyens dans l’adaptation au climat. Ces recherches s’inscrivent dans la littérature émergente des services climatiques participatifs, où la co-production des connaissances joue un rôle central. La co-production est ici entendue comme une pratique normative impliquant « la collaboration délibérée de différentes personnes pour atteindre un objectif commun ».
Les recherches seront examinées à travers le prisme des défis socio-climatiques spécifiques auxquels sont confrontés les acteurs locaux des territoires des Alpes et du Jura, reconnus comme des zones sensibles au changement climatique en raison de leur vulnérabilité à la perte de biodiversité, à la dégradation des habitats, aux problèmes de quantité et de qualité de l'eau douce, ainsi qu'aux modifications paysagères. Les enjeux liés au stress hydrologique et aux événements climatiques extrêmes seront analysés sous les angles individuel, sectoriel et communautaire, permettant des comparaisons entre les deux sites pilotes : la grande région grenobloise et les montagnes du Jura.
Compétences :
- Formation de Master en géographie, sciences de l’environnement, sciences sociales ou école d’ingénieur dans le domaine de l’environnement
- Expérience préalable dans la communication auprès de publics variés (acteurs non-académiques ; acteurs académiques)
- Expérience souhaitée en matière de collecte et de traitement de données quantitatives (observations ou projections hydroclimatiques) et qualitatives (entretiens, ateliers participatifs)
- Expérience souhaitée en matière de conception des approches Coupled Human and Natural System (CHANS)
- Bonne capacité de synthèse et de qualités rédactionnelles, en français comme en anglais
- Capacité à travailler en équipe et dans un contexte inter- et transdisciplinaire
Contexte de travail
Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet kNOW-HOW+4°C récemment retenu pour financement dans le cadre de l’appel à projet du PEPR TRACCS. Ce projet vise à explorer les savoirs socio-climatiques et les récits permettant de concrétiser et d'essaimer l’adaptation territoriale systémique à un futur à +4°C. Les recherches doctorales seront co-encadrées par Galateia TERTI, Maitresse de Conférence à l’UGA et Sandrine ANQUETIN, Directrice de Recherche au CNRS et seront menées à l’IGE, plus spécifiquement au sein de l’équipe HydroMétéorologie, Climat et Interactions avec les Sociétés (HMCIS). L’équipe HMCIS possède une expertise dans les jeux sérieux et les simulations participatives, qui ont exploré l’usage des prévisions probabilistes pour la gestion des crises météorologiques.
Ces recherches doctorales s’articulent également avec la structure d’intermédiation science-société GREC Alpes-Auvergne, affiliée à l’OSUG, et offrent de nombreuses opportunités de collaboration au sein des initiatives en cours et à venir de l’IGE.
Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.
Contraintes et risques
Aucun
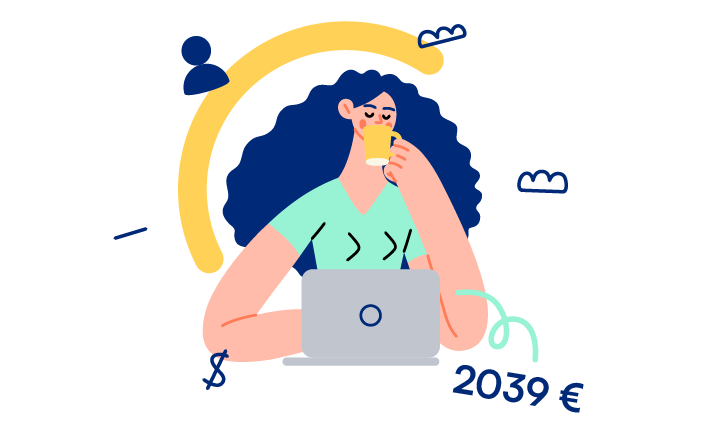
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.