
Liberté de religion et liberté d’expression en droit français. Étude au prisme du droit européen et québécois
La thèse s’inscrit dans le champ de l’analyse des rapports entre liberté de religion et liberté d’expression. Alors que ces deux libertés sont fortement protégées en droit, la persistance de situations conflictuelles s’observe particulièrement lorsque, dans une situation de diversification des formes d’affiliation religieuse, la manifestation des croyances par des individus ou des groupes se réclamant d’une organisation ou d’une doctrine religieuse emprunte des modalités éloignées des cadres rituels classiques protégés par la liberté de religion. Les discours religieux en ligne (le « numérique religieux ») en sont une illustration patente. Une telle expression des croyances relève-t-elle de la liberté de religion ou de la liberté d’expression ? Existerait-il une liberté d’expression religieuse ? Plus précisément se pose la question de l’identification des limites opposables à ces expressions. S’agit-il de mobiliser les considérations de sécurité et d’ordre public ? S’agit-il de prosélytisme protégé par la liberté de religion ? Ou ces expressions sont-elles appréhendées à l’aune des limites propres à la liberté d’expression ?
Ces questionnements n’ont à ce jour pas fait l’objet d’une approche systématique. Il s’agit donc de mettre au jour comment le droit appréhende ces sources d’expression des croyances religieuses.
La rareté des travaux juridiques, en France, sur cette question précise, conduit à se tourner vers d’autres systèmes juridiques pour se doter d’éléments d’analyse, voire pour proposer de nouvelles interprétations des catégories existantes et/ou de nouvelles catégories propres à saisir les spécificités de la liberté d’expression religieuse. De ce point de vue, mettre en perspective les systèmes français et canadien présente un double intérêt : d’une part la laïcité rapproche les deux modèles de régulation du fait religieux, d’autre part les variations d’un continent à l’autre dans la protection de la liberté d’expression permettent d’envisager différentes réponses juridiques aux situations d’expression religieuse. Pour chaque système juridique, le relevé systématique des opérations de qualification sera analysé à la lumière de données issues d’entretiens avec les acteurs judiciaires afin de saisir les contextes et les sources de tensions.
Contexte de travail
La personne recrutée sera affectée au laboratoire Droit, religion, entreprise et société (UMR 7354 DRES) situé à la Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA), à Strasbourg, au cœur du campus universitaire, très bien desservi par les transports en commun. Le laboratoire interroge la complexité des relations juridiques et sociales dans un monde en perpétuel mouvement. Le laboratoire réunit en son sein un large spectre de disciplines organisées en quatre équipes : droit des religions, religion et pluralisme, droit social, droit des affaires. L’effectif est de 50 membres permanents et de 70 doctorant.e.s. La personne recrutée intégrera l’équipe « Droits et religions » et bénéficiera de l'environnement de travail (salle spécifique, soutien à la mobilité) des doctorants de l'UMR.
La thèse sera réalisée en cotutelle avec l’Université de Montréal (pressentie).
Site de l’UMR : https://dres.unistra.fr/
Contraintes et risques
La/le doctorant(e) sera administrativement rattaché(e) à l’UMR DRES et inscrit(e) à l’ED 101. La/le doctorant(e) sera amené(e) à effectuer des séjours de recherche au Québec
Les productions scientifiques issues de ses travaux devront être déposées systématiquement dans une archive ouverte, de préférence HAL.
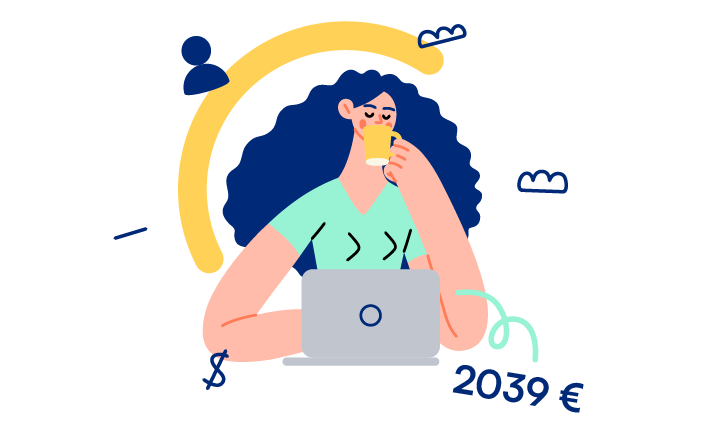
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.