
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec 272 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France.INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.
Environnement de travail, missions et activités
Vous exercerez votre activité au sein de l'unité LESSEM "Laboratoire et Sociétés en Montagne".
Vous bénéficierez des moyens de fonctionnement nécessaires à la bonne réalisation de votre travail : poste de travail, ordinateur et logiciels, participation du personnel d’appui à la recherche, utilisation des véhicules de service pour les déplacements.
Vous serez encadré-e par Laurent Bergès, ingénieur-chercheur LESSEM INRAE Grenoble.
Vos missions sont financées par deux projets de recherche :
1- projet SYLVALP "Mieux comprendre la richesse végétale des forêts à enjeux du Massif des Alpes" [2023-2027] (https://cbn-alpin.fr/sylvalp ). Ce projet est financé par le FEDER Programme Provence-Alpes-Côte d’Azur et Massif des Alpes FEDER/FSE+/FTJ 2021-2027 : "Lutter contre l'érosion de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes du Massif des Alpes".
2- projet Monitor "Système agile de monitoring écologique des forêts" du programme PEPR FORESTT Résilience des forêts [2024-20230] (https://www.pepr-forestt.org/ ).
Vous contribuerez à trois tâches du projet Sylvalp (Tâches A, C, et D ci-dessous) et à réaliser une tâche du projet Monitor (Tâche B), dont les objectifs partagés portent sur les évolutions à long terme des forêts alpines et de leur diversité floristique.
Vous serez intégré à l'équipe projet de ces deux projets. A ce titre, vous interagirez avec les membres du LESSEM impliqués (Philippe Janssen, Yves Schaeffer) et les partenaires des deux projets : l'UMR Silva Nancy (Cyrille Rathgeber, Noémie Delpouve, Jean-Luc Dupouey, Sandrine Chauchard, Christian Piedallu), le LECA (Philippe Choler, Baptiste Nicoud, Arthur Bayle), le CBNA (Ornella Kristo), et possiblement avec des chercheurs italiens (projet GEOLUCA, Matteo Garbarino et coll.).
Contexte des recherches
L'étude des changements de couverture et d'usage du sol (LULCC) sur le temps long est d'une importance cruciale pour comprendre comment le passé façonne les paysages actuels et leur biodiversité, et mieux prévoir les conséquences des modifications actuelles et futures du paysage (Kaim et al. 2016). A cet égard, une expansion générale des forêts est observée depuis le minimum forestier, atteint vers 1850 en France (Bergès et Dupouey 2021). Dans les montagnes, l’expansion peut se traduire par une remontée de la limite supérieure des forêts, transition entre les étages subalpin et alpin. Le réchauffement global, les exigences écologiques des essences forestières, l’abandon pastoral, et le développement du tourisme interagissent pour moduler la dynamique de la limite supérieure des forêts (Delpouve et al. 2025). A la suite de la thèse de N. Delpouve ces travaux et d'autres travaux réalisés sur les paysages méditerranéens (PNR Luberon, Abadie et al. 2018), des études se poursuivent pour analyser et comprendre comment les paysages de montagne ont évolué depuis le minimum forestier du milieu du 19 ème siècle dans les Alpes, notamment pour comprendre où a eu lieu la reconquête forestière (Anselmetto et al. 2024, Marengo et al. 2025).
Connaître les changements d'usage depuis 1850 permet d'identifier les forêts à longue continuité temporelle dites "forêts anciennes" (Bergès et Dupouey 2021). La continuité temporelle et la maturité forestière sont considérées comme deux piliers majeurs de la naturalité des écosystèmes forestiers (Cateau et al. 2015). L'ancienneté se rapporte donc à l'usage du sol tandis que la maturité concerne l'âge du peuplement forestier. Une forêt mature se caractérise par la présence de très gros arbres (diamètre > 70 cm), d'arbres morts debout, de bois mort au sol et de dendromicrohabitats (Fuhr et al. 2022).
Concernant la réponse de la biodiversité à la continuité forestière, une littérature assez fournie souligne que les héritages agricoles sur les plantes vasculaires de sous-bois peuvent persister pendant des siècles, voire des millénaires, après l'abandon agricole et la reconstitution de la forêt (Bergès et Dupouey 2021). Ces héritages des usages passés sur les communautés floristiques s'expliquent par deux mécanismes qui fonctionnent comme des goulots d'étranglement au cours du processus de colonisation : (a) la limitation par la dispersion, à la fois dans le temps et dans l'espace, et (b) la limitation par le recrutement et la persistance des espèces (Hermy et al. 2015). Cependant, peu de travaux ont concerné d'une part les forêts montagnardes et subalpines (Janssen et al. 2017, Mollier et al. 2022a, b) et d'autre part la flore non vasculaire, i.e. bryophytes et lichens (Mollier et al. 2022a, Molder et al. 2015, Dymytrova et al. 2018).
Concernant la maturité forestière, une réponse négative de la diversité des plantes vasculaires à la mise en réserve ou à l'arrêt de l'exploitation est souvent observée (Mölder et al. 2014, Sabatini et al. 2014, Lelli et al. 2021), suggérant l'absence ou la rareté de plantes vasculaires spécialistes des stades matures (Burrascano et al. 2018). Mais cette tendance n'est pas systématique : par exemple, une absence de différence de richesse entre réserves et zones exploitées est notée dans les sites du projet GNB (Gosselin et al. 2017, Wei et al. 2020).
En revanche, les bryophytes forestières ont une réponse à la gestion forestière assez différente de celle des plantes vasculaires forestières : elles font partie des groupes dont la richesse spécifique est significativement plus élevée en réserve (Paillet et al. 2010, Gosselin et al. 2017, Müller et al. 2019) et diminue avec l'intensité de la gestion (Horvat et al. 2017). Le bois mort, dont l'abondance et la diversité augmentent avec l'âge des peuplements et l'absence d'exploitation, constitue un substrat plus important pour les bryophytes (et les lichens) que pour les plantes vasculaires, notamment dans les zones de montagne (Dittrich et al. 2014, Chmura et al. 2016), même si le bois mort peut constituer un support accessoire pour certaines plantes vasculaires (Chećko et al. 2015). Une analyse de la bryoflore présente sur différents substrats (sol, rocher, bois mort, souches, bois vivants) dans 26 hêtraies-sapinières-pessières plus ou moins matures de l'étage montagnard des montagnes de l'Ain révèle un effet de la maturité sur la composition spécifique en bryophytes et un effet positif de la maturité sur la richesse spécifique, mais seulement pour les substrats ligneux (bois mort au sol, bois vivant et souche, Vacher 2020).
Cependant, peu de travaux portent en zone de montagne sur de vastes territoires (Mollier et al. 2022b). Le croisement entre des cartes d'ancienneté et de maturité potentielle, produites dans le cadre du projet SYLVALP sur une partie du Massif des Alpes, et des bases de données floristiques du CBNA permettrait d'élargir significativement l'échelle d'analyse spatiale et de monter en généralité dans l'analyse des effets de l'ancienneté et de la maturité forestière sur la flore des Alpes.
Dans ce contexte, vous serez en charge des 4 tâches suivantes, détaillées ci-dessous.
A) Synthèse de l’évolution des occupations du sol dans le Massif des Alpes depuis 1850 et analyse de leurs déterminants biophysiques et socio-économiques
En élargissant et en approfondissant le travail précédent sur les Parcs nationaux de la Vanoise et du Mercantour (Thomas et al. 2017), et en s'inspirant de l’approche développée par Abadie et al. (2018) sur le PNR Luberon, les objectifs de cette tâche sont : (1) de caractériser les transitions des usages du sol entre 1850 et aujourd'hui, en précisant la persistance et les changements des usages, en ciblant en particulier la question de la reconquête forestière et (2) d'analyser les déterminants biophysiques et socio-économiques de la distribution des usages (forêt, pâture, culture) et de leurs changements sur le massif des Alpes.
Vous croiserez la carte vectorielle des usages passés de l’état-major (réalisée à l'étape précédente dans le projet SYLVALP (cf. aussi le projet Cartofora http://www.gip-ecofor.org/cartofora ) avec la couche actuelle BD Carto de l’IGN (en la complétant par d’autres couches pour disposer de l’ensemble des occupations du sol sur le territoire d'étude).
Ceci vous permettra d’identifier les zones qui sont stables entre les deux dates et celles qui changent d’usage pour les principales occupations du sol (forêts, cultures, vergers, prairies, pelouses, zones urbaines). Vous calculerez ensuite des matrices de transition entre usages à partir du croisement de cartes existantes à différentes dates. Ensuite, vous établirez une liste de déterminants biophysiques et socio-économiques potentiels sur la base de la littérature et rassemblerez les données disponibles. Enfin, vous pourrez analyser les données par des modèles de régression par arbre aléatoire (random forest) ou d'autres méthode plus classique, telle que la régression logistique, afin de détecter les principaux facteurs expliquant la persistance, la progression ou la disparition d’un usage donné, en ciblant les forêts, les pâtures, les prairies de fauche et les cultures. Vous pourrez utiliser les statistiques bayésiennes pour intégrer la corrélation spatiale des données (librairie R-INLA).
B) Analyse des directions de l'expansion forestière dans les Alpes et les Pyrénées depuis 1850
En complément de la tâche A, et à la suite de la thèse de N. Delpouve (2025) portant sur la remontée altitudinale de la limite supérieure de la forêt dans les Alpes du Nord et les Pyrénées, vous vous appuierez sur les données disponibles et les analyses effectuées sur ces deux massifs français afin d'analyser finement les directions de l'expansion forestière et les facteurs pouvant expliquer sa variabilité.
Plus précisément, vous comparerez la vitesse de l'expansion forestière dans les Alpes et les Pyrénées depuis 1850 dans les deux principales directions : en altitude et le long des courbes de niveaux (un type d'analyse qui, à notre connaissance, n'a exploré que pour analyser les déplacements d’aires de distribution d’espèces de montagne, cf. Samira Geres et al. 2025). L'hypothèse principale que vous testerez est qu'en moyenne, la vitesse d'expansion forestière est plus élevée lorsque la forêt progresse en colonisant des anciens milieux ouverts (pâtures ou cultures) présents à l'étage subalpin que lorsque la forêt colonise des anciens milieux ouverts présents dans l'étage alpin.
Vous aurez à votre disposition les cartes vectorisées des usages anciens de la carte d'état-major de 1850, une carte préliminaire des forêts de 1950 établie récemment à partir des plus anciennes photographies aériennes disponibles et des anciennes cartes topographiques de l'IGN (qu'il faudra valider avant de l'utiliser), et les BD Forêt V1, V2 et V3 (si cette version est parue).
Vous aurez à mettre au point une méthode d'analyse spatio-temporelle permettant de distinguer l'orientation (par rapport au gradient d'altitude) des variations de couverture forestière au cours du temps. Pour affiner l'analyse directionnelle de l'expansion forestière en zone de montagne et comprendre sa variabilité, vous pourrez réutiliser selon les besoins les cartes des facteurs biophysiques et socio-économiques mobilisés à la tâche A.
C) Etablissement des listes territorialisées d’espèces indicatrices de forêts anciennes et de forêts récentes (déclinées en fonction du type d’usage passé) et liste d'espèces indicatrices de forêts matures
Les listes à établir concerneront prioritairement la flore vasculaire et la bryoflore (la lichénoflore pourra être analysée en complément, en fonction des données disponibles). Vous utiliserez les données floristiques existantes dans les BD du CBN Alpin. Vous extrairez les données en ciblant les relevés dont la localisation géographique est précise, en s'inspirant du protocole établi dans le cadre du stage de Master 2 d'E. Martiné (2019).
Une fois les données d’occurrence des espèces sélectionnées et mises au format pour les traitements statistiques, vous croiserez la position des points d’inventaire (1) avec la carte d’ancienneté forestière de manière à définir si le relevé était en forêt ancienne ou en forêt récente et (2) avec la carte de maturité forestière potentielle (Fuhr et al. 2022), pour les secteurs où ces informations sont disponibles. En complément, vous préparerez une liste de variables environnementales pour corriger statistiquement les effets d’autres paramètres environnementaux qui peuvent être en partie corrélés à la continuité ou à la maturité forestière (en complétant si besoin les données des tâches A et B). Ces variables concernent le climat (température, précipitations, durée d'enneigement, nb de jours de gel), la topographie (altitude, pente, exposition, position topographique), le sol (pH, azote, carbone, phosphore, % cailloux, profondeur de sol, texture) et le peuplement forestier (couvert de la canopée et composition en essences).
Vous pourrez établir les listes d'espèces indicatrices en découpant le territoire du massif des Alpes selon la logique des sylvo-écorégions de l’IGN (https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?article773 ). Vous pourrez appliquer des analyses multivariées (type ACC) et des régressions logistiques pour tester si la composition spécifique des relevés ou la probabilité de présence d’une espèce est expliquée statistiquement par la continuité ou la maturité forestière, tout en tenant compte de l’effet des autres facteurs potentiellement confondants dans l’analyse (climat, topographie, sol, peuplement) et de l'autocorrélation spatiale des observations. Vous pourrez là aussi utiliser les statistiques bayésiennes.
D) Effet de la continuité et de la maturité forestière sur la diversité fonctionnelle des plantes du Massif des Alpes
En vous basant sur les analyses menées dans la tâche C, vous poursuivrez le travail en analysant la réponse des traits de vie des plantes à la continuité forestière et à la maturité, afin de définir les traits de vie associés aux forêts anciennes et les traits de vie associés aux forêts matures des étages montagnard et subalpin.
Les traits des plantes vasculaires pourront être extraits de différentes bases de traits, notamment TRY (Kattge et al. 2011), Baseflor (Julve 2011), la base EIVE des valeurs bio-indicatrices pour l'Europe (Tichý et al. 2023), complétées par les traits proposés par Midolo et al. (2023) concernant la sensibilité ou la tolérance des espèces aux perturbations naturelles et anthropiques. Les traits de vie des bryophytes seront puisés dans la base "Bryophytes of Europe Traits" (van Zuijlen et al. 2023).
Vous pourrez analyser les relations entre les facteurs historiques/écologiques et les traits fonctionnels des espèces au moyen d'une analyse RLQ couplée à une analyse Fourth-corner (Dray et al. 2014, Bergès et al. 2017), ou par le biais d'un modèle linéaire généralisé multi-espèces (Brown et al. 2014, Warton et al. 2015, Mollier et al. 2022a), et si possible en utilisant les approches bayésiennes. Les résultats obtenus seront synthétisés et confrontés aux hypothèses et à la littérature.
Résultats attendus
A- Synthèse des changements d’usage du sol depuis 1850 et identification des principaux déterminants abiotiques et socio-économiques de ces changements à l’échelle du Massif des Alpes ;
B- Variabilité de l'expansion forestière selon la direction de cette expansion depuis 1850 à l’échelle du massif des Alpes ;
C- Liste des espèces végétales indicatrices de longue continuité forestière et liste d'espèces végétales indicatrices de maturité forestière par sylvo-écorégions du Massif des Alpes ;
D- Réponse des traits de vie des plantes vasculaires et non vasculaires à l'usage passé du sol et à la maturité forestière à l’échelle du Massif des Alpes.
Valorisation
Vous serez en charge de la rédaction de 3 articles scientifiques (un pour chaque tâche A, B et D) en collaboration avec les partenaires des projets. Vous rédigerez également un article technique (et possiblement d'un data paper) pour la tâche C. Vous rédigerez les parties des rapports d'avancement et rapports finaux vous concernant dans le cadre du rapportage des projets SYLVALP et Monitor. Vous pourrez présenter vos résultats à un colloque national et un colloque international (SFE², Ecoveg, IAVS, IMC…).
Delpouve, N. (2025). Dynamique des forêts subalpines dans le contexte des changements globaux : patrons, déterminants (abiotiques, paysagers et socio-économiques) et conséquences sur la diversité floristique (Thèse de Doctorat), Université de Lorraine Nancy.
Gosselin, M., C. Bouget, F. Archaux, Y. Paillet, V. Boulanger, N. Debaive, and F. Gosselin. 2017. Projet GNB : synthèse des relations entre naturalité anthropique, naturalité biologique et biodiversité. RDV Techniques ONF 56:56-64.
Janssen, P., Fuhr, M., & Bouget, C. (2017). L’ancienneté n’est pas un déterminant majeur de la biodiversité dans les massifs forestiers des Préalpes du Nord. Revue Forestière Française, 69(4-5), 427-440.
Martiné, E., 2019. État de conservation de la trame de forêt ancienne sur le site de la Basse Vallée de l’Isère. Rapport de stage de Master 2, Irstea, AgroParisTech, Université de Montpellier, Montpellier, 31 p.
Thomas, M., Bec, R., Abadie, J., Avon, C., Bergès, L., Grel, A., & Dupouey, J.-L. (2017).Changements à long terme des paysages forestiers dans cinq parcs nationaux métropolitains et le futur Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne. Revue Forestière Française, 69(4-5), 387-404.
Vacher, J. 2020. Réponse des bryophytes et des chiroptères à la maturité et à d’autres variables environnementales dans les forêts du Haut-Bugey. Rapport de stage de Master 2. Université Rennes 1.
Formations et compétences recherchées
Formation recommandée: thèse en écologie des communautés ou de la conservation, géographie physique ou environnementale.
Connaissances souhaitées: analyse de données statistiques sous R, analyses spatiales (QGIS, ArcGIS).
Expérience appréciée: écologie historique et/ou géo-histoire
Aptitudes recherchées: autonomie, rigueur, capacités de rédaction en français et en anglais
Votre qualité de vie à INRAE
En rejoignant INRAE, vous bénéficiez(selon le type de contrat et sa durée) :
Les personnes accueillies à INRAE, établissement public de recherche, sont soumises aux dispositions du Code de la fonction publiquenotamment en ce qui concerne l’obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité. A ce titre, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’elles soient ou non au contact du public, elles ne doivent pas manifester leurs convictions, par leur comportement ou leur tenue, qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques.> En savoir plus : site fonction publique.gouv.fr
LESSEM - Laboratoire Ecosystèmes et Sociétés En Montagne
#J-18808-Ljbffr
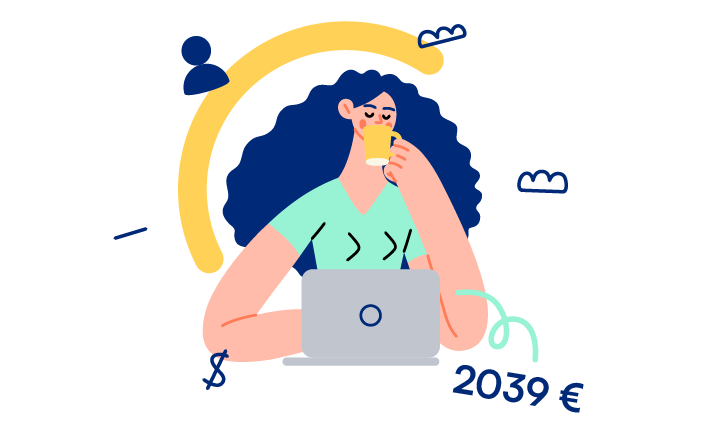
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.