
Contexte du recrutement et définition de poste :
Objectifs du stage : Comprendre les influences de la fréquentation sur l’acceptation et l’appropriation de la réserve naturelle nationale du Tanet-Gazon du Faing et caractériser les types de fréquentations.
Analyser les jeux d’acteurs et les stratégies mises en place par ces acteurs pour permettre la coexistence des enjeux de protection de la nature et d’accueil des visiteurs (qu’ils soient touristes ou usagers locaux).
Le ou la stagiaire aura pour mission d’effectuer une campagne d’entretiens semi-directifs auprès des
riverains, pratiquants et acteurs socio-professionnels dans la réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing.
Une campagne de questionnaires est aussi attendue auprès des pratiquants dans la réserve. Il ou elle aura ensuite à analyser les données obtenues dans un mémoire ou un rapport de stage.
Face au constat d’augmentation de la fréquentation et de diversification des activités, le gestionnaire
doit disposer d’un diagnostic complet de la forte fréquentation de la réserve pour mettre en place des mesures de gestion adéquates. L’étude se base sur deux dimensions : les nuisances perçues par les communautés locales et la réduction de la qualité de l'expérience des visiteurs. L’étude concernera précisément les données relatives à la perception de la fréquentation par les acteurs locaux et des visiteurs. Cette perception pourra être abordée par plusieurs aspects : perception de l’affluence sur les sentiers, gênes occasionnées, nuisances sonores, etc. De plus, le stage pourra apporter des réponses supplémentaires au gestionnaire sur la perception du public sur d’autres thématiques liées à la réserve (signalétique, travaux, etc.) et sur son acceptation sociale.
Durée : 6 mois (entre début mars 2026 et fin septembre 2026), temps plein
Tâches :
Appropriation de la littérature
Observations de terrain
Mise en place d’une enquête par entretiens (identification des parties prenantes et des
interlocuteurs à rencontrer, construction du guide d’entretien)
Réalisation, retranscription et analyse des entretiens semi-directifs
Mise en place d’une enquête par questionnaires sur le terrain
Valorisation des résultats obtenus à travers la réalisation d’un rapport de stage et d’une
soutenance de stage
Contexte de la réserve :
Depuis sa création, la RNN du Tanet-Gazon du Faing est considérée comme un espace naturel très
fréquenté. Cette fréquentation a été estimée à environ 250 000 personnes/an et est suivie par de
nombreux dispositifs de comptage automatique sur l’ensemble des sentiers de la réserve (éco
compteurs). La circulation routière sur la route des crêtes, porte d’entrée de la réserve hors période
hivernale, est également suivie quantitativement par un boîtier de comptage routier (en lien avec le
conseil départemental des Vosges) et par un comptage des véhicules sur les parkings réalisé par l’équipe de la réserve. Ainsi, du 24 mai au 13 novembre 2024, la portion col du Calvaire – col de la Schlucht de la route des crêtes a été empruntée plus de 160 000 fois par des véhicules avec des pics allant jusqu’à 2 700 véhicules/jours durant les week-ends prolongés. Outre ces données chiffrées, la réserve a également initié plusieurs suivis des impacts environnementaux de la fréquentation, notamment le suivi de l’érosion des sentiers ainsi que les impacts sonores de la route sur la réserve (projet WilderPass). De nombreux dispositifs de canalisation de la fréquentation sont également mis en place : clôtures, fermeture de sentiers, jalonnage des sentiers en hiver, etc.
Des recherches récentes sur le tourisme durable et la gestion des flux touristiques, ont mis en avant la nécessité de prendre en compte non seulement les effets environnementaux mais aussi les perceptions locales et les attentes des visiteurs dans la définition des problèmes liés à la forte fréquentation.
Une première approche sociologique a été initiée par la réserve au début des années 2000. En 2001, le CEN sollicite le LASTES (Laboratoire de sociologie du travail et de l’environnement social) afin de réaliser une étude visant à analyser les représentations que les habitants se font de la réserve naturelle et de les comparer avec celles des acteurs participants (ou ayant participé) à la vie de cette dernière en tant qu’outil de protection. Cette étude devait apporter des clés au gestionnaire pour l’amélioration de la prise en compte du site par les habitants des communes sur lesquelles est implantée la réserve.
Si cette dernière a apporté quelques pistes sur la représentation de la réserve par les habitants, aucune étude complète et encadrée n’a été réalisée sur la perception des visiteurs fréquentant le site. En effet, l’équipe de la réserve a continué de collecter des informations sur les visiteurs via des questionnaires remplis à l’issue d’actions de maraudage. Ces questionnaires très simples comprenant des informations essentielles (région de provenance des visiteurs, âge, fréquence de venue sur le site, etc.) avaient pour objectif de décrire des profils type par saison. N’entrant dans le cadre d’aucun protocole, ces données sont restées parcellaires et ne permettent pas une analyse des données.
La crise du Covid-19 aurait généré des phénomènes de « surfréquentation » mais que l’on peine à
estimer. Sur la réserve du Tanet-Gazon du Faing, les enjeux liés à la fréquentation deviennent de plus en plus forts compte tenu de son augmentation et sa diversification (profils, pratiques) dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de changement climatique.
Contexte scientifique du stage :
Ce stage s’inscrit dans le projet FRESQUE, qui analyse les articulations entre fréquentation, acceptation sociale et appropriation des espaces protégés. Les travaux de sociologie et de géographie ont montré que la fréquentation est un fait socialement construit (Chamboredon, 1985 ; Picon, 1991) et qu’elle peut générer conflits d’usages (Cadoret, 2011 ; Daumalin et Cadoret, 2018) autant que des opportunités de développement local (Duvivier, 2021). À l’international, Manning (2007, 2009) a développé la notion de capacité de charge sociale à partir d’exemples états-uniens.
La pertinence de l’expression « surfréquentation » (Laslaz, 2005, 2007) est discutée par la littérature :
C. Gauchon (2012) parle de « dérives du discours sur la surfréquentation » (p. 257), dont l’emploi peut donner lieu à une instrumentalisation. Les sociologues C. Barthélémy et C. Claeys (2016) ont montré que la « surfréquentation » est une notion hautement subjective, perçue et vécue différemment selon les usagers de l’espace. L’usage de cette expression dans les discours permet ainsi de justifier de mesures de régulation comme la mise en place de quotas de visiteurs, de restrictions d’accès ou de frais d’entrée ou de stationnement déjà analysés dans d’autres contextes (Laslaz, 2011 pour le lac d’Allos (Mercantour) ; Girault et Laslaz, 2015 pour le Parc national de Samaria (Crète) ; Platania, Rizzo, 2018 pour l’Etna ; Cadoret, 2021 pour le Parc national de Port-Cros). Elle peut relever d’un « réflexe conditionné dès lors que l’on se soucie de la conservation d’un site : alors que l’on ne dispose d’aucune indication sur la fréquentation réelle […],
chacun postule a priori qu’[il] risque la sur-fréquentation, sans jamais se poser la question de ce que serait un seuil admissible ni pour quel objectif de conservation. » (Gauchon, 2012). Paradoxalement, la « surfréquentation » peut parfois être utilisée comme un argument pour attirer davantage de visiteurs en mettant en avant la popularité d'un site ou d'une destination. Ainsi, elle est exploitée de manière opportuniste pour justifier ou promouvoir différents objectifs, qu'ils soient liés à la protection de l'environnement, à la gestion des flux, aux conflits d'usages ou à la promotion touristique.
Ainsi, la forte médiatisation des questions de « surtourisme » et de « surfréquentation » de certains lieux touristiques, consécutive à une crise sanitaire mondiale s’étant traduite par plusieurs périodes de confinement, a conduit à conforter la mise à l’agenda politique de cette question. Elle a aussi suscité intérêt et questionnements dans le champ scientifique, comme le montrent des publications récentes sur ces notions très discutées (Hatt et Clarimont, 2023 ; Gay, 2024). La gestion des flux s’avère particulièrement ardue à mettre en œuvre dans des espaces naturels ouverts, aux « portes d’entrée » multiples et envisagés par les visiteurs comme des espaces d’accès libre et gratuit. Cette recherche prend la suite d’une thèse soutenue en 2023 (Robert-Kérivel, 2023) qui a révélé, entre autres, les articulations fortes entre fréquentation et acceptation sociale des espaces protégés, celle-ci étant tantôt un levier pour l’acceptation, tantôt un frein.
La réserve du Tanet-Gazon du Faing, par sa forte fréquentation et la diversité de ses usages, constitue un terrain idéal pour explorer ces enjeux :
Attachement au territoire et représentations locales,
Valeurs allouées aux réserves,
Tensions entre usages professionnels, touristiques et conservation,
Processus de négociation et compromis entre acteurs.
Profil recherché :
Profil et compétences attendues : compétences en SHS générales
Permis B indispensable (véhicule de terrain mis à disposition par le CEN)
Compétences en recherche qualitative
La maîtrise des outils de recherche quantitative serait un plus
Intérêt pour les approches pluridisciplinaires, bonnes capacités à appréhender, assimiler et
connecter plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales
Capacité à spatialiser les analyses
Connaissances des territoires de montagne et intérêt pour l’étude des liens entre les sociétés et
les environnements, notamment sur la fréquentation touristique et sur les espaces protégés
Bonnes capacités relationnelles
Bonnes capacités rédactionnelles
Esprit de synthèse et d’analyse requis
Maîtrise des techniques d’analyse et/ou de traitement qualitatif souhaitable
La maîtrise de logiciels de SIG serait un plus
Autonomie dans l’organisation du travail
Conditions du stage :
Le stage se déroule sur une durée de 6 mois (entre début mars 2026 et fin septembre 2026). Le ou la stagiaire sera accueilli·e par le CEN Lorraine (antenne de Gérardmer). Le stage est gratifié selon la réglementation nationale en vigueur. Les frais de déplacement sur le terrain sont pris en charge.
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer avant le 15 novembre 2025 à :
Et
Après étude de votre dossier de candidature, vous serez sollicité·e pour un entretien de sélection en
visioconférence ou vous serez informé·e de votre non-sélection.
Pour toute question relative à cette offre de stage, n’hésitez pas à nous contacter.
Axelle Tempé
Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine
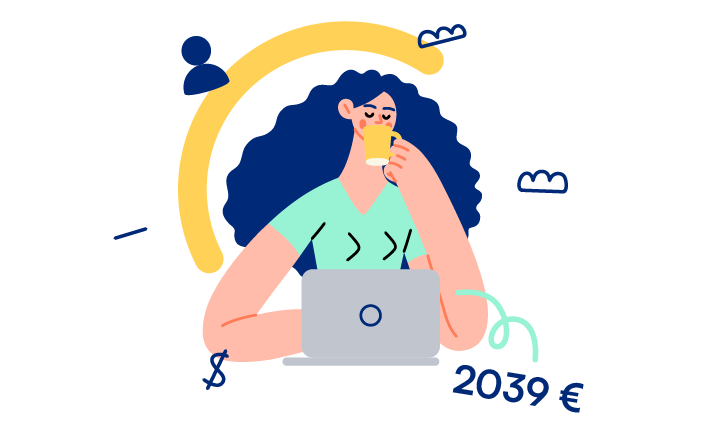
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.