
En France, environ 2 % de la population est touchée par des plaies chroniques, souvent source d'inconfort et de dégradation de la qualité de vie. Ces plaies peuvent également entraîner des handicaps significatifs, et dans certains cas, des complications infectieuses pouvant compromettre le pronostic vital des patients. Parmi les options thérapeutiques pour traiter les plaies chroniques, l’utilisation de plasmas froids apparaît comme une solution prometteuse. Ce projet vise à développer une nouvelle source de plasma à pression atmosphérique, à caractériser les mécanismes de cicatrisation et l’activité bactéricide de la source plasma sur des modèles de plaies infectées in vitro.
Dans un premier temps, le doctorant recruté sera chargé de développer des modèles de plaies à partir d’épiderme humain reconstitué (RHE). Des marquages immunohistologiques seront réalisés sur ces modèles afin d’analyser la fermeture des plaies par microscopie à fluorescence. Parallèlement, le doctorant évaluera l'efficacité antibactérienne du plasma sur des bactéries modèles en forme végétative (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa) déposées sur des supports de peau acellulaires, tels que des matrices de collagène. Ces modèles acellulaires simplifiés permettant de s’affranchir dans un premier temps des interactions complexes avec les cellules vivantes. Cette approche facilitera la caractérisation des paramètres plasma optimaux (temps d'exposition, puissance, composition gazeuse) avant leur application sur les modèles cellulaires plus complexes.
Dans un deuxième temps, le doctorant développera des modèles de plaies chroniques infectées. Pour ce faire, il utilisera des substituts dermiques et des RHE, avec ou sans plaies, infectés par des biofilms de Staphylococcus epidermidis. En plus des marquages par immunofluorescence, des analyses complémentaires par microscopie électronique à balayage (MEB) pourront être envisagées afin d’évaluer l'infection et son impact sur la cicatrisation des plaies générées.
Enfin, le doctorant caractérisera les effets du plasma sur les cellules cutanées et les biofilms bactériens. Cela inclut l'évaluation des impacts du plasma sur la viabilité, la migration cellulaire et le stress oxydant des kératinocytes et des fibroblastes cultivés en 2D. Il analysera également les effets du plasma sur les modèles RHE, notamment en ce qui concerne la fonction barrière et la perméabilité cellulaire. Pour terminer, des modèles de peau infectée par des biofilms seront utilisés pour évaluer l'impact du plasma sur ces biofilms.
Ce poste requiert de solides compétences en biologie cellulaire ainsi qu’une bonne maîtrise du développement des modèles 3D in vitro de peau. Des compétences en immunohistochimie, immunofluorescence, microscopie confocale (biphoton) et analyse d’image seront nécessaires pour mener à bien ce projet. Enfin des compétences en bactériologie et dans le développement de biofilms bactériens seront un plus.
Contexte de travail
La thèse sera menée dans le cadre d’un projet collaboratif TIRIS qui réunit des expertises complémentaires en physique des plasmas, biologie et sociologie issues de 3 laboratoires (DPHE, IPBS et LISST) de l’université de Toulouse. Les travaux seront réalisés dans l’équipe de biophysique cellulaire de l’Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS) de Toulouse et l’équipe de diagnostic des plasmas hors équilibre (DPHE) de l’Institut de National Universitaire Champollion à Albi. Les travaux de thèse seront dirigés par M. Golzio (IPBS) et C. Muja (DPHE). Des campagnes expérimentales seront réalisées au sein des deux laboratoires, avec l’IPBS comme site principal. Le doctorant participera à l'organisation de focus groups analysant l'appropriation de la technologie plasma par les usagers.
Contraintes et risques
Risques biologiques de type 2
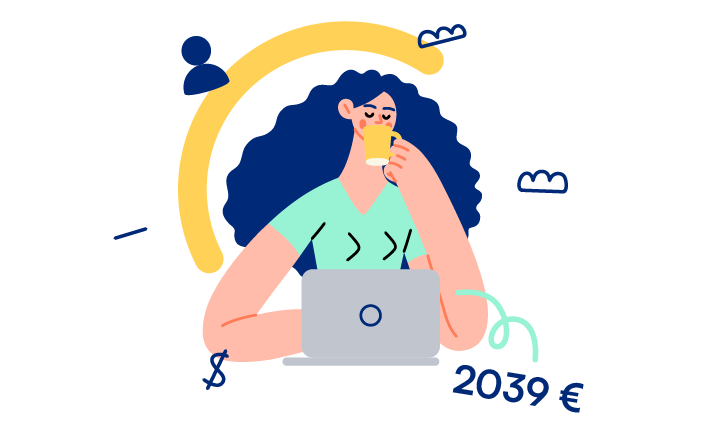
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.