
Contexte du recrutement et définition de poste :
Proposition de STAGE de Master 1 pour l’année 2025-2026
Réponse de la biodiversité aérienne et souterraine aux pratiques gestion et fertilisation dans l’estuaire de la Seine
Contexte
L'estuaire aval de la Seine est un territoire fortement anthropisé par la mise en place d'un certain nombre d'ouvrages limitant l'effet de la marée sur les zones alluviales associées et donnant lieu à un estuaire cloisonné. La chenalisation, l'endiguement, la présence de ponts sont autant de constructions qui influent sur la dynamique naturelle du fleuve et de la marée et donc sur le fonctionnement écologique des écosystèmes adjacents. L'un des facteurs les plus modifiés par l'ensemble de ces aménagements est la connexion des zones alluviales au fleuve. En effet, l'aménagement de l'embouchure de la Seine, de 1853 à 2000, se traduit par une réduction significative de la mobilité des eaux du fleuve et donc par un changement dans la structuration des habitats connexes. Les aménagements portuaires et l'endiguement des rives Nord et Sud ont eu pour conséquences de façonner le milieu en plusieurs unités paysagères identifiées au sein de la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de Seine (RNNES) qui s'étend sur 4000 ha de zones humides terrestres et 4500 ha de zones maritimes.
En termes d'usages agricoles, les prairies humides présentent une gestion basée sur la fauche et un pâturage extensif (bovins). A l'échelle de la Réserve, la pratique la plus répandue est la fauche qui représente plus de 60 % de la surface. Cependant, une gestion mixte associant fauche et pâturage de regain a tendance à se développer depuis quelques années (4ème plan de gestion de la RNNES). Ces activités agricoles s’accompagnent d’une fertilisation encadrée par le 4ème plan de gestion qui autorise un apport d’engrais strictement limitée à la valeur maximale de 40 kg (NPK)/ha/an sur les prairies du marais du Hode et celles de Cressenval quel que soit le mode de gestion, fauche, pâturage ou mixte.
Ce sujet de stage s’insère dans le projet FERTI (effet de la FERTIlisation sur la biodiversité et la production des prairies humides de l’estuaire de Seine), financé par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et co-porté avec la Maison de l’Estuaire (MdE), le laboratoire ECODIV, la Chambre Régionale d’Agriculture Normandie (CRAN) et le Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de l’Estuaire de la Seine (GEPAES). Ce projet a pour objectif de tester l’effet de la fertilisation sur un dispositif de suivis in situ des prairies humides de la RNNES sur lesquelles deux types d’apport d’intrants minéraux sont testés (N seul et mélange NPK) par comparaison à une modalité témoin (0 apport).
Le projet a démarré au printemps 2025 par la mise place du dispositif expérimental installé principalement sur les prairies du marais du Hode sélectionnées selon la gestion opérée : 1) sur des parcelles fauchées et 2) sur des parcelles fauchées et subissant un pâturage de regain en fin d’été. Dans chaque parcelle sélectionnée, un dispositif de suivis est implanté sur deux zones se différenciant topographiquement : 1 zone haute et 1 zone basse afin de prendre en considération l’hétérogénéité topographique des prairies.
La chambre d’agriculture est chargée d’appliquer les deux modalités de fertilisation. Elle réalise également les prélèvements de biomasse pour évaluer la quantité et la qualité fourragère du dispositif. Un premier état des communautés biologiques (faune du sol et flore) a été réalisé en Juin-Juillet 2025 par le laboratoire ECODIV. Les suivis seront reconduits en 2026 et 2027. Une thèse a démarré sur le sujet le 1er Octobre 2025.
A plus longs termes, les résultats de ces travaux permettront de nourrir les réflexions sur l’élaboration du futur plan de gestion de la réserve de l’Estuaire prévu pour 2028 et de statuer sur l’autorisation ou l’interdiction de la fertilisation.
Objectif et missions
Le stage propose d’étudier l’effet de la fertilisation (N, NPK) en fonction du type de gestion (fauche ou fauche + pâturage) et de la topographie (zone basse ou élevée) dans la réserve de l’estuaire de la Seine. L’objectif du/de la stagiaire sera d’aider aux suivis floristiques et faunistiques.
Au cours du stage, le/la stagiaire sera amené(e) à :
1. Aider à l’identification de certains taxons de faune du sol déjà collectés (à déterminer) en soutien à la thèse en cours
2. Réaliser des inventaires botaniques, de faune du sol et de la strate herbacée
3. Aider aux mesures de traits fonctionnels sur quelques espèces végétales ciblées (à définir)
4. Analyser les résultats
5. Rédiger un rapport de stage
Lieu, durée et conditions du stage
6. Structure d’accueil : Laboratoire Ecodiv USC INRAE 1499, Université de Rouen, UFR Sciences et Techniques, Bâtiment n°44, Place Emile Blondel, 76821 Mont-Saint-Aignan
7. Durée : 3 mois – de Avril à Juillet 2026 (date de début de stage à discuter selon contraintes académiques).
8. Conditions : Stage gratifié selon les modalités légales (4,35 euros/h en 2025)
Contacts des encadrants
9. Pierre Ganault (enseignant-chercheur), Université de Rouen, laboratoire Ecodiv,
Courriel : pierre.
10. Lauréane Delacour (Doctorante), Université de Rouen, laboratoire Ecodiv,
Courriel : laureane.
Dossier de candidature
Profil recherché :
Profil souhaité (Niveau/Compétences)
11. Etudiant(e) en Master 1ème année en Ecologie, Sciences du Sol ou Sciences des milieux d’interface.
12. Bonne aptitude au travail de terrain.
13. Compétences naturalistes.
14. Esprit pratique, autonomie, bonne capacité rédactionnelle.
15. Intérêt pour la recherche appliquée.
16. Connaissances appréciées en traitements statistiques (utilisation de R).
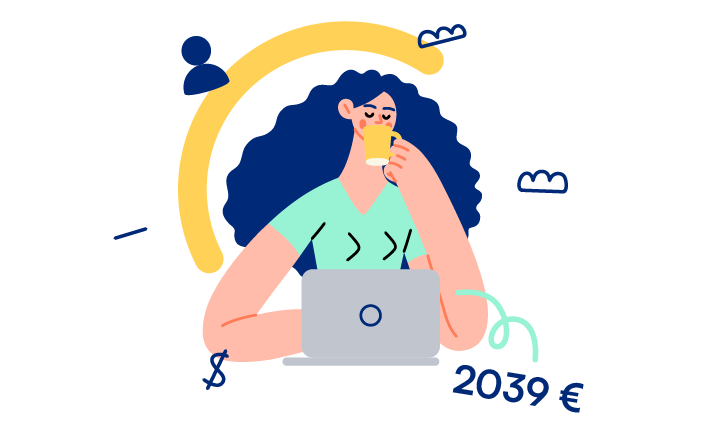
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.