
Mission
Le Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine est à un stade de maturité, qui lui a permis, grâce à la recherche d’excellence qui s’y réalise à travers la programmation scientifique de haut niveau dans ses créneaux mère-enfant, de recevoir au cours de la dernière année, des dons majeurs qui seront transformationnels et ouvriront d’innombrables perspectives pour la recherche en santé des enfants. Le Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine réunit une équipe de plus de 1200 personnes, soit plus de 295 chercheuses et chercheurs, dont plus de 160 en recherche clinique et plus de 580 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et stagiaires de recherche postdoctorale œuvrant dans des domaines d’expertise multiples. Travaillant étroitement avec les équipes de soins du CHU Sainte-Justine, cette communauté se dévoue à la recherche fondamentale, clinique et translationnelle au sein de six axes de recherche.
Projet
L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) recherche un(e) Responsable de projets, Recherche sur les toxicomanies engagé(e) et compétent(e) pour diriger et soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives stratégiques de recherche et de partenariats en santé mentale à travers le Canada. Ce poste est basé au Centre de recherche Azrieli (CRA) – CHU Sainte-Justine à Montréal et relève du Directeur scientifique associé (DSA) de l’Institut. L’IRSC-INSMT a pour mandat de soutenir la recherche visant à améliorer les connaissances sur le cerveau, la santé mentale, la santé neurologique, la vision, l’audition et le fonctionnement cognitif, et à réduire le fardeau des troubles connexes par des stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement, de systèmes de soutien et de soins palliatifs. La mission de l’IRSC-INSMT est de promouvoir l’excellence en recherche innovante et éthiquement responsable au Canada, afin d’accroître nos connaissances sur le fonctionnement et les troubles du cerveau et de l’esprit, de la moelle épinière, des systèmes sensoriels et moteurs, ainsi que sur le bien-être mental et toutes les formes de dépendance. L’IRSC-INSMT vise à améliorer la vie des Canadiens par la création de connaissances, le renforcement des capacités et l’innovation en recherche en santé. Le/la Responsable, Recherche sur les toxicomanies contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies nationales de recherche, à la conception d’occasions de financement et à la promotion de collaborations entre les secteurs universitaire, clinique, politique et communautaire. Un aspect essentiel de ce rôle consiste à faire progresser la recherche qui répond aux besoins uniques des diverses populations au Canada, notamment les jeunes, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que d’autres communautés en quête d’équité, conformément à l’engagement des IRSC envers l’équité, la diversité, l’inclusion et la recherche en santé autochtone tout au long de la vie. Le rôle implique également de comprendre les nouvelles technologies qui faciliteront la recherche en santé mentale.
Tes défis
Élaboration stratégique de programmes :
1. Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives stratégiques de recherche liées à l’usage de substances, en mettant l’accent sur les besoins émergents, la santé publique, les trajectoires de consommation, les modèles de prévention et d’intervention, ainsi que les approches novatrices de prestation de services.
2. Soutenir les initiatives et priorités de recherche qui répondent aux réalités de diverses populations touchées par l’usage de substances, y compris les communautés autochtones, les groupes racialisés, les nouveaux arrivants, les jeunes et d’autres populations mal desservies.
3. Participer au développement des possibilités de financement liées à la recherche sur l’usage de substances, depuis les consultations préliminaires jusqu’à la version finale.
4. Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets, de plans d’action et de stratégies dans les domaines prioritaires liés à l’usage de substances.
5. Appuyer les activités annuelles d’évaluation des initiatives en usage de substances, notamment la validation des données, la rédaction et la coordination des sondages d’évaluation, ainsi que la préparation de rapports.
Engagement des parties prenantes et partenariats :
6. Établir et maintenir des relations avec les chercheurs, les prestataires de services, les organisations autochtones, les organismes gouvernementaux, les groupes de défense, les personnes ayant une expérience vécue de l’usage de substances et d’autres partenaires afin d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives stratégiques.
7. Favoriser des partenariats inclusifs qui reflètent la diversité sociale et culturelle du Canada, et contribuer à des relations respectueuses et réciproques avec les peuples autochtones, en reconnaissant la nécessité d’approches fondées sur les distinctions.
8. Représenter l’organisation dans les réseaux, conférences et groupes de travail nationaux et internationaux pertinents.
9. Diriger et faciliter les consultations auprès de diverses parties prenantes telles que les chercheurs, les organismes gouvernementaux, les décideurs et les groupes communautaires; résumer, évaluer et diffuser les résultats; recommander des stratégies pour maximiser les retombées des consultations.
10. Collaborer avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, d’autres instituts ou organismes partenaires, y compris les organisations non gouvernementales et les organismes nationaux de santé, au besoin.
11. Identifier des occasions pour développer le réseau institutionnel et contribuer aux activités de recherche sur l’usage de substances.
12. Promouvoir le mandat, les stratégies et les programmes liés à l’usage de substances lors d’événements publics.
13. Identifier de nouveaux partenaires potentiels dans les domaines prioritaires liés à l’usage de substances.
14. Participer à des groupes de travail internes et externes, au besoin.
Soutien aux politiques et à la recherche :
15. Surveiller et analyser le paysage de la recherche, les données probantes émergentes, les développements politiques et les innovations dans les services relatifs à l’usage de substances.
16. Contribuer à la rédaction et à la création de documents de communication internes et externes, tels que des notes de politique, des plans stratégiques, des rapports annuels, des rapports d’atelier, des documents d’information, des exposés de position, des propositions de financement et des présentations qui éclairent les initiatives stratégiques.
17. Évaluer en continu les programmes liés à l’usage de substances, formuler des recommandations et mettre en œuvre des améliorations.
18. Surveiller et rendre compte des progrès vers les indicateurs de performance, analyser les tendances et collaborer à l’atteinte des objectifs.
19. Appliquer une connaissance approfondie des enjeux liés à l’usage de substances pour répondre aux demandes de la communauté scientifique et des ministères gouvernementaux, en assurant l’exactitude et la pertinence des informations fournies.
Mobilisation des connaissances et collaboration :
20. Collaborer étroitement avec les équipes internes et externes pour coordonner les initiatives de recherche sur l’usage de substances entre les instituts et les secteurs.
21. Contribuer à la planification, l’organisation, la facilitation et l’évaluation d’événements tels que des réunions de parties prenantes, des ateliers, des tables rondes, des webinaires et d’autres activités d’engagement.
22. Collaborer avec les équipes de communication et de mobilisation des connaissances pour promouvoir l’échange de connaissances dans le domaine de l’usage de substances et favoriser l’application des données probantes dans les politiques, la pratique clinique et les services communautaires.
23. Soutenir les initiatives interinstituts et intersectorielles, notamment par la coordination d’activités liées à l’élaboration de possibilités de financement.
24. Fournir des rapports réguliers aux parties concernées concernant la planification, la mise en œuvre et les résultats des projets.
25. Diriger la préparation de présentations et de produits de mobilisation des connaissances de haute qualité, exacts et adaptés au public, pour des conférences, réunions et webinaires.
26. Maintenir une compréhension approfondie de la mission, des valeurs et des stratégies de l’organisation et des initiatives liées à l’usage de substances.
27. Représenter l’institution lors de réunions ou événements, au besoin.
28. Faire preuve de professionnalisme, de discrétion, de courtoisie et de respect dans toutes les interactions avec les partenaires internes et externes, contribuant à une image positive de l’organisation.
Profil
Tes acquis et talents
29. Diplôme d’études supérieures en santé publique, psychologie, études autochtones, psychiatrie, politiques de santé, travail social ou dans une discipline connexe, idéalement dans le domaine de la recherche en toxicomanie (doctorat ou expérience équivalente souhaité).
30. Au moins 3 à 5 ans d’expérience en recherche, en politiques ou en élaboration de programmes dans le domaine de la toxicomanie.
31. Connaissance démontrée du paysage canadien de la recherche en santé et des systèmes de toxicomanie, avec une solide compréhension des cadres de bien-être mental autochtone et des approches de soins culturellement sécuritaires.
32. Expérience de travail dans des environnements collaboratifs impliquant de multiples parties prenantes et avec des populations en quête d’équité.
33. Solides compétences en gestion de projets, communication, analyse et réflexion stratégique.
34. Le bilinguisme (français/anglais) constitue un atout important.
35. Un haut niveau de précision et d’attention aux détails est essentiel.
36. Capacité démontrée à travailler de manière autonome, à gérer les priorités et les échéances, et à assumer la responsabilité de la gestion des initiatives.
37. Capacité à évoluer dans un environnement de travail complexe et multifacette et à être un joueur d’équipe solide.
38. Excellentes compétences interpersonnelles et en communication, nécessaires pour traiter une variété de situations, y compris des questions complexes, sensibles et confidentielles.
39. Précision et attention aux détails requises, avec la capacité de prioriser des demandes souvent contradictoires.
40. Capacité à travailler sous pression.
41. Maîtrise des applications Microsoft Office telles que Word, Excel et PowerPoint, ainsi que des systèmes de gestion de fichiers basés sur le cloud (y compris OneDrive).
42. Solide compréhension de la mission, des valeurs et des plans des IRSC et de l’IRSC-INSMT.
Notre offre
Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), non syndiqué, avec une période de probation d’un (1) an. Ce poste est normalement prévu pour la durée de la subvention de l’INSMT. La rémunération varie entre 55 282.10$ et 97 962.73$/an selon l’échelle en vigueur au CHU Sainte-Justine et en fonction de l’expérience pertinente reconnue. Les autres conditions sont établies en fonction des normes en vigueur au CHU Sainte-Justine. Modèle de travail hybride possible (présentiel + télétravail). Disponibilité requise pour des horaires flexibles. Des déplacements peuvent être nécessaires.
Date d’entrée en fonction : Immédiat
Nous tenons à préciser que les candidats étrangers devront avoir un permis de travail valide pour le CHUSJ. Tout permis de travail ayant la condition suivante ne sera pas éligible : « Pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des enfants, à l'enseignement au primaire ou au secondaire, au domaine de la santé ».
Fin de l'affichage: 3 décembre 2025
Autres avantages
1. Une conciliation travail et vie personnelle :
43. Plan de vacances avantageux
44. 20 jours de vacances par année pour le personnel
45. 13 jours fériés
46. 9,6 jours de maladie par année
47. Congé de maternité, de paternité et d’adoption
2. Des avantages collectifs concurrentiels :
48. Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
49. Assurances collectives pour vous et votre famille
50. Programme d’aide aux employés et à leur famille
3. Des établissements facilement accessibles
51. Station de métro Université-de-Montréal, lignes d’autobus et grands axes routiers à proximité
52. Abri à vélos sécurisé et stations BIXI à proximité
53. Située dans le quartier Côte-des-Neiges
4. Des services sur place pour vous simplifier la vie:
54. Centre de la petite enfance Sainte-Justine
55. Nettoyeur et service de couture
56. Activités sportives
57. Service alimentaire qui encourage l’agriculture biologique et locale
58. Livraison de paniers de légumes biologiques
Remarques
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Le CHU Sainte-Justine souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les Autochtones à poser leur candidature. Nous vous serions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.
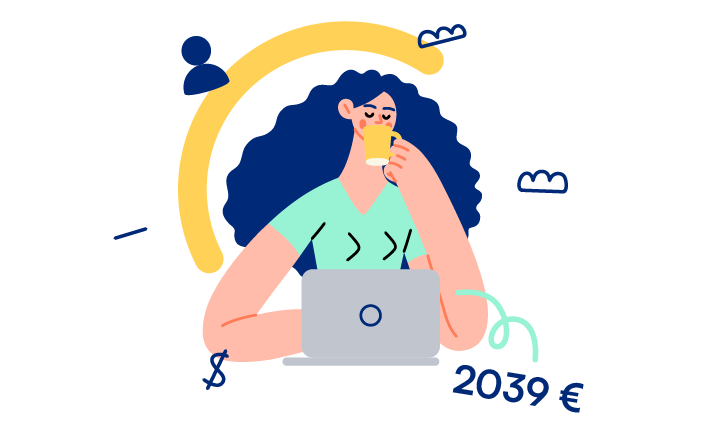
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.