
Description du sujet
Organisme porteur projet : Conservatoire National des Arts et Métiers
Anse du Cul-de-Loup
L’anse du Cul de Loup à l’extrême Nord-Est du département de la Manche (Normandie, France), est une baie ouverte au sud et localisée entre les communes de Saint-Vaast-la-Hougue à l’est et Quettehou à l’ouest (Figure 1).
Depuis longtemps connue pour son environnement calme (port Viking) dans le contexte hydrodynamique extrême du Cotentin, l’anse du Cul-de-Loup a fait l’objet depuis le XVIIe siècle de nombreux changements morphologiques : frange littorale et zone intertidale. Au nord des constructions Vauban de la Hougue, une digue a permis la fermeture de l’est de l’anse. Au cours du XIXe siècle, sa partie nord-ouest est endiguée puis urbanisée. Depuis les années 1970, l’anse abrite des parcs ostréicoles couvrant actuellement une superficie de 95 hectares. Un terre-plein est construit au nord de la Hougue et une digue perpendiculaire isole une partie de la baie en arrière du cordon de galet qualifiée de schorre. Depuis ces modifications récentes, un envasement conséquent de la baie est constaté.
Ce comblement vaseux engendre des problématiques environnementales et économiques dans une zone classée Natura 2000 et ZNIEFF 1 et 2. Les herbiers à zostères sont en déclin et la production aquacole connaît une baisse des rendements. Des informations sur les concessions ostréicoles et leurs impacts hydrodynamiques permettent d’expliquer en partie ces évolutions.
Pour comprendre l’évolution future de la zone, il est nécessaire de quantifier le niveau d’influence de chacun des facteurs qui agissent sur l’environnement côtier.
Projet PROTEC
Le programme « Projet de Territoire : Anse du Cul-de-Loup » (PROTEC), co-financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le CNAM/Intechmer (septembre 2022 – septembre 2024), a pour objectif de dresser un état des lieux environnemental des caractéristiques sédimentaires et hydrodynamiques de l’anse du Cul-de-Loup. Trois échelles de temps sont ciblées : annuelle, séculaire et holocène (10 000 ans).
En automne 2022, l’analyse sédimentaire a permis de dresser la carte des principaux modes granulométriques de la couverture sédimentaire superficielles et de mettre en évidence l’envasement progressif de l’anse dans sa partie est et nord-est. Des mesures et analyses ont également été effectuées pour comprendre l’organisation des gradients hydrodynamiques et les sources et puits sédimentaires.
Les gestionnaires doivent disposer d’outils pour étudier les scénarios de gestion et les modèles numériques permettent de simuler l’impact des modifications des processus sur l’évolution sédimentaire et morphologique.
Objectifs du projet MHysCo
Pour adopter de bonnes pratiques de gestion du domaine côtier, le projet vise à disposer de procédures et d’outils pour :
• prévoir à court et moyen termes l’évolution de l’hydrodynamique et de la dynamique sédimentaire associée ;
• appréhender un espace géographique en relation avec la nature des processus responsables des principales modifications morphologiques ;
• estimer les modifications de la qualité des sédiments en relation avec les agents forçant.
La mise en place d’un modèle numérique réclame l’agrégation des connaissances et informations des processus naturels modélisés sur la zone d’étude. Une fois validé, le modèle pourra être utilisé pour évaluer des cas et faire apparaître des informations là où aucune observation n’a été réalisée.
Le travail proposé consiste en la mise en place d’un modèle numérique hydro-sédimentaire basé sur une approche RANS pour l’anse du Cul-de-Loup (Normandie, France).
Méthode
La mise en place du modèle numérique doit permettre aux gestionnaires et décideurs locaux de prendre les meilleures mesures pour une conservation de la qualité environnementale et de l’économie locale. Le code de calcul CROCO (Coastal and Regional Ocean COmmunity model) est utilisé pour modéliser l’hydrodynamique côtière et régionale, avec des possibilités de couplage avec d’autres modèles. Le module MUSTANG (MUd and Sand TrAnsport modelliNG) représente la dynamique sédimentaire et est intégré à CROCO. MUSTANG peut prendre en compte plusieurs types de sédiments et des mélanges, bien que des aspects restent à valider dans le cadre de sa nouvelle intégration à CROCO.
Cas particulier des tables ostréicoles : environ 45 % de l’anse est couvert par des concessions de culture d’huîtres. Leur présence influence l’hydrodynamique et le comportement des sédiments et doit être prise en compte dans le modèle. Des approches similaires ont été utilisées dans la littérature pour simuler l’effet des structures sur la rugosité du fond, et une approche simplifiée sera reprise et testée en 3D dans CROCO pour ce contexte.
Tâche A
Valider les résultats CROCO-MUSTANG sur des cas test documentés et analyser le code Fortran de MUSTANG pour identifier les fonctionnalités réelles et, le cas échéant, modifier le code ou ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Tâche B
Après validation (Tâche A), mettre en place un modèle hydro-sédimentaire de l’anse en tenant compte des informations PROTEC. Définir les caractéristiques du domaine, les grilles, le modèle de marée et la présence des tables ostréicoles, puis réaliser des premières simulations et valider les résultats avec des données existantes.
Le modèle sédimentaire MUSTANG sera développé ultérieurement à partir des données de couverture sédimentaire et sera validé avec les résultats PROTEC et d’autres données.
Tâche C
Mesures hydrodynamiques inside les parcs ostréicoles (ADV, courantomètres, capteurs, etc.) et accès à une zone de production via un partenariat entre le CNAM/Intechmer et le LPMA pour un site atelier.
Résultats attendus
Le modèle numérique hydro-sédimentaire permettra d’identifier les principaux facteurs de la dynamique sédimentaire et des modifications morphologiques, notamment l’impact des tables ostréicoles sur les courants et les déplacements sédimentaires. Le modèle sera utilisé pour évaluer des scénarios et estimer l’influence du dérèglement climatique sur l’environnement et l’économie locale. L’objectif est de pouvoir faire varier les conditions initiales du modèle pour tester différents scénarios (par exemple, suppression des défenses, perméabilité des routes, poursuite de la montée du niveau marin).
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg
Lieu d’accueil : CNAM/Intechmer
Adresse : bv. de Collignon, 50110 Tourlaville, Cherbourg en Cotentin
Responsable : Emmanuel Poizot, Ingénieur de Recherche HDR
Spécialité : Géosciences marines
Mail : emmanuel.poizot@lecnam.net
Tél : 02 33 88 73 42
Encadrement1 : Sébastien Donnet, Maître de Conférence
Spécialité : Océanographie physique
Mail : sebastien.donnet@lecnam.net
Tél : 02 33 88 54 92
Encadrement2 : Gwendoline Grégoire, Maître de Conférence
Spécialité : Sédimentologie marine
Mail : gwendoline.gregoire@lecnam.net
Tél : 02 33 88 73 36
Mots clés : CROCO-Mustang, ostréiculture, sédiment, transport sédimentaire, hydrodynamique, environnement
#J-18808-Ljbffr
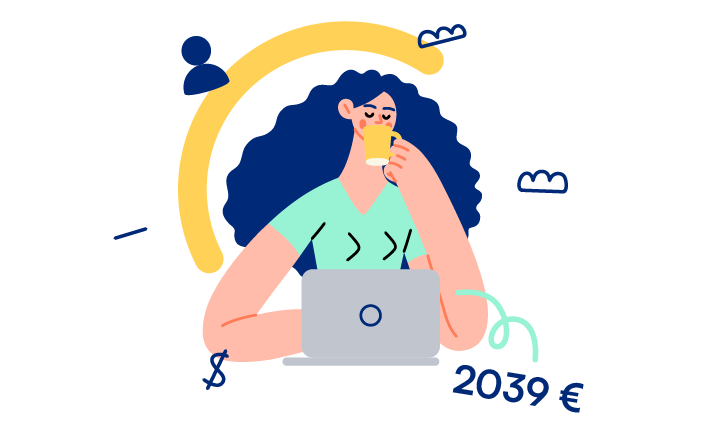
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.